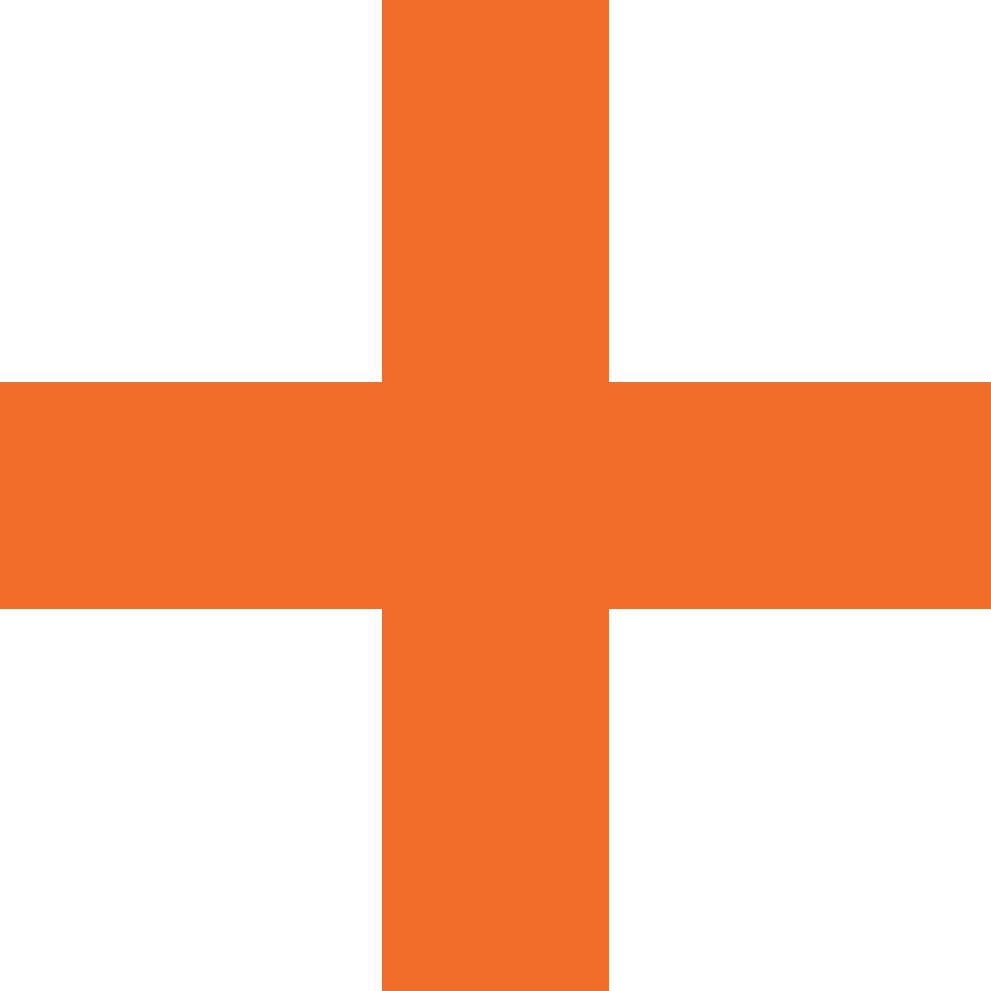Les coopératives
-
Une coopérative d’habitation est un organisme sans but lucratif qui vise à fournir à ses membres des logements au meilleur prix. La coopérative est la société propriétaire de l’immeuble. Son capital est constitué des parts sociales souscrites par les coopérateurs. Autrement dit, l’habitat en coopérative constitue une voie intermédiaire entre la location traditionnelle et la propriété privée.
-
Dans les coopératives d’habitation, les loyers sont fixés de manière à couvrir uniquement les coûts (construction, gestion et entretien), alors que d’ordinaire les loyers sont fixés afin de permettre au bailleur de réaliser un certain rendement. Une étude de l’Office cantonal de la statistique confirme que les loyers en coopérative sont entre 27 et 35 % plus bas que dans les logements ordinaires, et jusqu’à 42 % pour les logements les plus anciens. Cette étude établit également que les loyers des coopératives sont plus stables sur la durée.
-
Les coopératives s’adressent à toutes les personnes partageant certains principes de vie collective et de gestion non lucrative. Pour y accéder, il faut en principe acquérir des parts sociales dont les montants varient selon les coopératives, mais qui restent généralement abordables. Le montant des parts sociales est récupéré en cas de départ. Par ailleurs, des aides ou des prêts pour acquérir les parts sociales existent via des fondations ou le canton.
-
Au 31 mars 2025, la FPLC recensait 133 coopératives propriétaires de 12'400 logements, ce qui représente seulement 5% de l’ensemble du parc de logements du canton.
-
Non, il existe une grand diversité de coopératives avec chacune son esprit et son mode de fonctionnement. Certaines sont très participatives, d’autres nettement moins. Certaines promeuvent une vie communautaire marquée, d’autres fonctionnent comme des immeubles ordinaires à but non lucratif.
-
L’État ne subventionne pas directement les coopératives, mais peut leur octroyer des droits de superficie sur des terrains publics, des garanties de prêts ou des aides ponctuelles. Ces dispositifs visent à soutenir la production de logements non spéculatifs.
-
Les coopératives construisent hors logique de rentabilité, ce qui leur permet d’investir dans des projets écologiques, bien conçus, durables. Plusieurs projets récents à Genève sont exemplaires sur le plan architectural et environnemental, avec une réduction drastique de leur empreinte carbone : matériaux durables, limitation du béton, recyclage, mutualisation des ressources, chauffage par data center, etc. Cela dépend de chaque projet mais les coopératives accordent généralement une importance de premier plan aux aspects écologiques.
-
Non. La plupart des coopératives proposent des logements privatifs avec des espaces partagés (salles communes, buanderie, chambres d’amis, etc.). Le degré de mutualisation varie selon les projets. Les coopérateurs et coopératrices peuvent participer à la définition du fonctionnement de la coopérative.
L’initiative
-
L’initiative vise à développer l’habitat coopératif et demande à l’État de Genève de s’assurer que, d’ici 2030, un socle de 10% de l’ensemble du parc de logements à Genève soit détenu par des coopératives d’habitation sans but lucratif. Si ce socle de 10% n’est pas atteint en 2030, un nouveau plan de développement de l’habitat coopératif devra être lancé par le Conseil d’État.
-
À Genève, depuis des décennies la crise du logement provoque une augmentation continue des loyers et des prix à l’achat, disqualifiant de nombreux jeunes, familles et aîné-e-s dans la recherche et l’obtention d’un logement adapté à leurs besoins et à leurs moyens. L’initiative a été lancée dans le but d’offrir une alternative au marché immobilier actuel en proposant des logements abordables et de qualité pour toute la population.
-
Parce que Genève ne compte qu’environ 5 % de coopératives actuellement. L’objectif est de diversifier l’offre et de permettre à plus de gens d’échapper aux loyers spéculatifs. En comparaison, Zurich ou Bâle font bien mieux. Ce n’est donc ni irréaliste, ni excessif.
-
Non, l’initiative n’augmentera pas le nombre de logements mais elle favorisera la construction de plus de logements construits et gérés par des coopératives d’habitation. Il y aura ainsi une meilleure répartition entre les coopératives d’habitation et les autres types de projets immobiliers qui représentent aujourd’hui environ 90% du marché immobilier actuel.
VRAI/FAUX
-
FAUX. La part de logements sociaux est fixée par la loi avec un minimum d’1/3. Il ne faut pas opposer logements coopératifs et logements sociaux puisque beaucoup de logements coopératifs sont souvent aussi des logements sociaux.
-
FAUX. Le délai fixé à 2030 ne constitue qu’un objectif général et non contraignant, tel que l’a confirmé le Tribunal fédéral. De plus, l’initiative prévoit ce qui doit être fait si l’objectif n’est pas atteint dans le délai, à savoir qu’un nouveau plan de développement de l’habitat coopératif devra être lancé par le Conseil d’État.
-
VRAI. Mais l’initiative permettra de faire en sorte que les logements qui seront construits sur les terrains disponibles répondent aux besoins du plus grand nombre, ce que permettent les coopératives d’habitation.
-
FAUX. Pour rappel, le droit de préemption permet à l’État (ou à une commune) de se substituer à l’acheteur (en principe au même prix) lors d’une transaction immobilière. Il suppose donc que le propriétaire du terrain souhaite le vendre et qu’un acheteur souhaite l’acquérir. En ce qui concerne l’initiative, l’État n’aura aucunement l’obligation de faire un usage systématique du droit de préemption. La loi confère un large pouvoir d’appréciation à la collectivité dans le cadre de l’exercice de ce droit. Il est également important de relever qu’il existe d’autres moyens que le droit de préemption pour mettre en œuvre l’initiative. Les terrains en mains publiques dans le secteur Praille-Acacias-Vernets devraient permettre de construire plusieurs milliers de logements en coopératives. Le Canton et de nombreuses communes disposent également de terrains qui pourraient être remis aux coopératives. Finalement, de nouveaux outils pourraient être créés, comme par exemple des prêts ou des cautionnements de prêts pour faciliter l’achat de terrains par les coopératives.
-
VRAI. Mais seulement une partie des nouveaux logements en coopérative construits pour répondre à l’objectif de l’initiative le seront sur des terrains acquis par le droit de préemption ou le fonds LUP. Le reste sera construit sur des terrains acquis par un autre biais (par exemple terrains historiques de l’Etat ou des communes, PAV, etc.). Ainsi, les logements coopératifs créés pour atteindre le socle des 10% seront, pour partie, des logements d’utilité publique, et pour partie des logements à loyers libres correspondant un niveau de loyer pour des revenus supérieurs mais également sans marge bénéficiaire.
-
FAUX. Les logements subventionnés (notamment HM) peuvent s’adresser à des niveaux de revenu de la classe moyenne.
-
FAUX. Les droits de superficie dont bénéficient les coopératives rapportent chaque année 5,4 millions à l’Etat et 1,6 millions à la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat coopératif (FPLC). En moyenne, sur la durée totale du droit de superficie (99 ans), la rente de superficie rapporte 2,8 fois le prix d’acquisition pour les terrains de l’Etat et 3,4 fois le prix d’acquisition pour les terrains de la FPLC. Par ailleurs, actuellement, l’État emprunte quasiment à taux zéro.